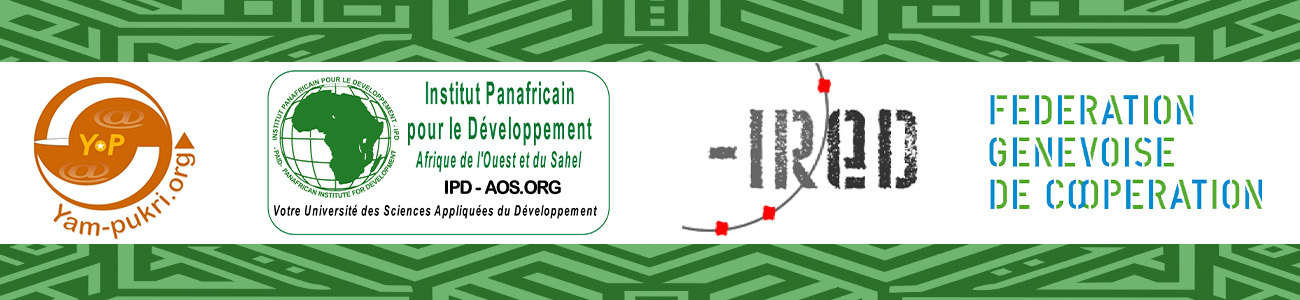Résumé : L’objectif de cet article est de mettre en lumière la contradiction entre
l’omniprésence des dynamiques des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en tant que levier des transitions dans les Suds, notamment en Afrique et dans les territoires ultramarins et leur quasi absence dans la littérature scientifique. En effet, si les dynamiques économiques sociales et solidaires sont largement présentes dans l’activité économique dans les Suds, cependant au niveau théorique et épistémologique, l’ESS dans les Suds constitue un angle mort dans les travaux scientifiques. Ce hiatus est d’autant plus surprenant qu’il existe dans les Suds, différentes formes d’organisations sociales apparentées à des structures de l’ESS. Sa renaissance a été provoquée par le diktat néolibéral du Consensus de Washington.
Au point qu’elle a pu être qualifiée de deuxième économie du continent africain au début des années 2000, et récemment d’aucuns l’ont considéré comme le moteur principal de l’économie africaine eu égard à sa contribution à l’emploi. Sa conceptualisation est alors une préoccupation de premier ordre. D’autant que, selon l’Organisation Internationale du Travail, les valeurs et les principes de l’ESS ont pris une place proéminente dans la législation récente sur le travail décent dans les Suds. Ce qui montre que ce ne sont pas nécessairement les statuts qui structurent la conceptualisation de L’ESS. Car il ne s’agit pas pour ces structures de se positionner, selon un mimétisme connu dans d’autres secteurs autour des critères retenus dans
les pays du Nord. Puisque dans la plupart des cas, le moteur de l’ESS est de relayer, voire de se substituer à l’État défaillant, rendu inopérant par les prescriptions néolibérales des institutions internationales au travers des plans d’ajustement structurel.