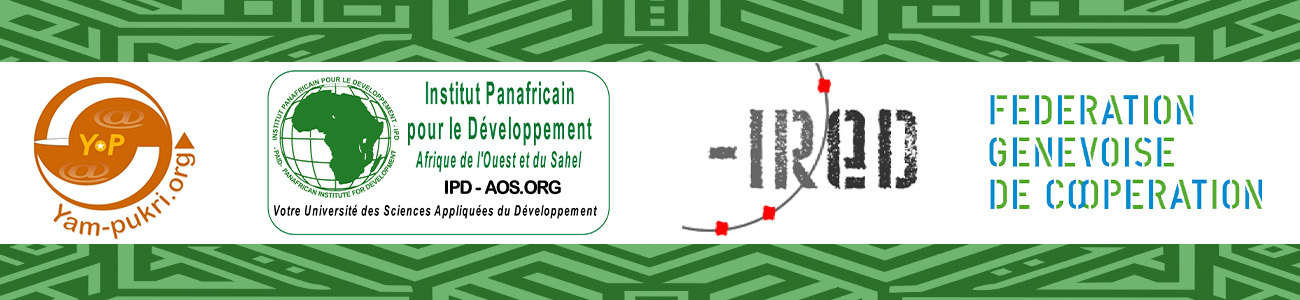Cet article analyse les contextes d’émergence du concept et des pratiques de l’économie sociale et solidaire (ESS) au Burkina Faso. À partir d’enquêtes de terrain menées auprès des réseaux de promotion de l’ESS dans ce pays, l’auteur montre que celle-ci résulte d’un processus de transfert des formes d’organisation de l’économie sociale importées par l’administration coloniale, qui s’inscrivaient dans une logique de domination et d’exploitation. Lors de l’Indépendance, l’État postcolonial s’est engagé sur un « sentier de dépendance » en instrumentalisant lesdites organisations au service de ses objectifs de développement. Dès les années 2000, on observe une nouvelle modalité de transfert de l’ESS moins caractérisée par la coercition. Ce processus a été initié par des universitaires et des acteurs de la société civile, sous l’influence d’organismes de coopération internationale.
Le transfert du concept d’économie sociale et solidaire (ESS) vers l’Afrique a été analysé par plusieurs chercheurs (Baron, 2007 ; Fall et Guèye, 2003 ; Soulama et Sarambé, 2000 ; Zett, 2013). Partant de contextes africains, leurs travaux rendent compte des pratiques qui incarnent le concept d’ESS, soulignant des résonances entre certaines réalités locales et ce concept forgé hors d’Afrique.
Fall et Guèye (2003) expliquent l’émergence et la relative réussite de l’ESS en Afrique par l’échec du modèle néolibéral, qui produit des exclusions, et la capacité de l’ESS à s’imprégner des logiques socioculturelles africaines, permettant de concilier le partage et l’accumulation de plus-values monétaires et symboliques.
Pour Baron (2007), l’apparition du concept d’ESS en Afrique s’accompagne de paradoxes liés à sa définition, à son rôle, qui varie considérablement d’une perspective (institutions internationales) à l’autre (altermondialistes), ainsi qu’à la question de son institutionnalisation. En outre, la cohabitation de l’ESS avec des réalités africaines préexistantes est source d’ambiguïtés. À ce sujet, Fonteneau, Nyssens et Fall (1999, p. 175) mettent « en garde contre les dangers d’une diffusion du terme d’économie sociale ou solidaire qui ferait fi d’une réflexion sur les réalités spécifiques de ces formes d’organisations au Sud, intimement liées au milieu dans lequel elles s’inscrivent ».
Dans le contexte burkinabè, le concept d’ESS renvoie principalement à cinq formes d’organisation, à savoir les coopératives, les coopératives d’épargne et de crédit (Coopec), les groupements villageois et/ou professionnels, les mutuelles sociales et les associations de développement (Zett, 2013)…
https://www.cairn.info/revue-recma-2021-4-page-36.htm?contenu=resume